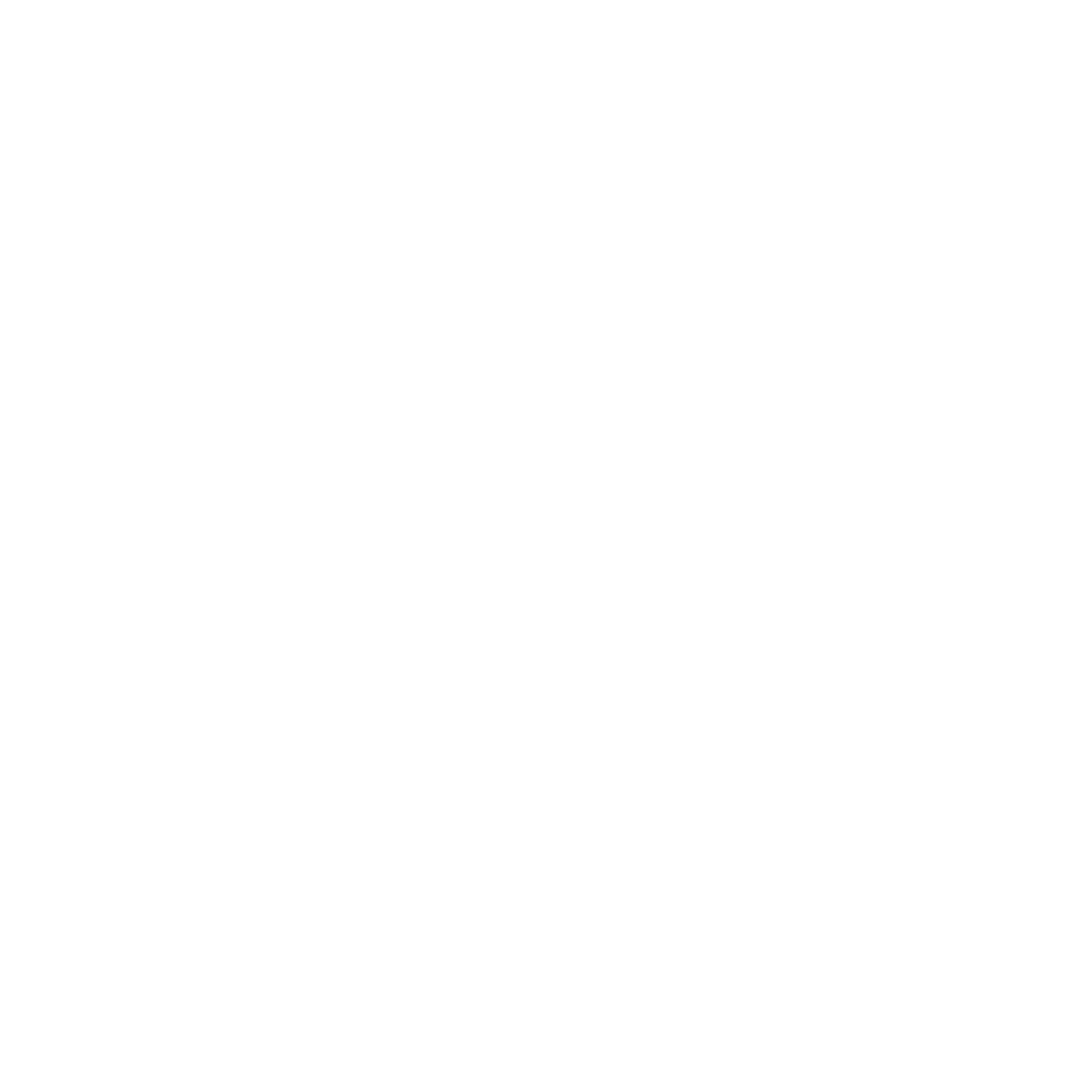Haïti : violence, pouvoir et destruction
Haïti traverse aujourd’hui une crise profonde où la violence n’est plus seulement un symptôme du désordre, mais un véritable mode de gouvernance. Entre la domination des gangs, l’effondrement de l’État et l’indifférence internationale, la situation haïtienne peut être analysée à travers plusieurs concepts philosophiques, notamment la nécropolitique d’Achille Mbembe, la comptabilisation de la violence d’Alain Gilles et la destruction des choses décrite par Wolfgang Sofsky.
Achille Mbembe, à travers sa notion de nécropolitique, montre comment le pouvoir ne se limite plus à gouverner la vie, mais aussi à administrer la mort. En Haïti, cette dynamique est évidente : l’État semble avoir abandonné sa mission de protection et laisse des groupes armés exercer un contrôle total sur certaines zones.
La population vit dans un état de terreur permanent, exposée aux exécutions sommaires, aux enlèvements et aux violences arbitraires. Les gangs, devenus de véritables autorités locales, décident qui peut vivre ou mourir, et cette insécurité permanente installe un régime de domination fondé sur la peur.
D’un autre côté, la comptabilisation de la violence, évoquée par Alain Gilles, permet d’éclairer la manière dont cette crise est perçue et traitée à l’échelle internationale. La situation en Haïti est souvent réduite à des statistiques : nombre de morts, d’enlèvements, de personnes déplacées. Ces chiffres, bien qu’alarmants, ont tendance à masquer la réalité humaine de la violence. Ils deviennent des données abstraites qui, bien que relayées dans les médias et les rapports d’ONG, ne suscitent pas de véritables actions politiques.
Cette gestion purement quantitative contribue à une forme d’indifférence, où la violence est normalisée et reléguée à un simple fait divers récurrent.
Enfin, Wolfgang Sofsky, dans Traité de la violence, analyse un aspect fondamental de la brutalité : la destruction des choses. En Haïti, la violence ne se limite pas aux corps ; elle vise aussi les infrastructures, les maisons, les institutions.
Les hôpitaux et les écoles sont pillés, les bâtiments publics incendiés, les marchés dévastés. Cette destruction systématique ne se contente pas d’anéantir des biens matériels : elle efface aussi les repères symboliques d’un peuple, détruisant ce qui permettrait une reconstruction.
Dans un pays où l’État est déjà fragile, cette désintégration matérielle accélère l’effondrement du tissu social et rend encore plus incertaine toute possibilité de stabilisation.
L’analyse de la crise haïtienne sous ces trois prismes révèle une situation où la violence ne se contente pas d’être un effet du chaos : elle devient un mode d’organisation du pouvoir.
L’absence de réponse concrète, que ce soit de la part des autorités haïtiennes ou de la communauté internationale, montre à quel point cette violence est non seulement tolérée, mais parfois même intégrée dans un système où la survie devient la seule règle.
Jean-Baptiste SUFFRARD
Communicologue, Formation en Anthropo-sociologie.