
Le pape François est mort à l’âge de 88 ans : l’Église perd un pasteur du monde, Haïti un ami du peuple
Le Vatican a annoncé ce lundi 21 avril 2025 le décès du pape François, survenu à 7h35 du matin. Il avait 88 ans. Quelques heures à peine après avoir offert une dernière salutation à la foule rassemblée pour les célébrations de Pâques, place Saint-Pierre, le 266e souverain pontife de l’histoire de l’Église s’est éteint, emportant avec lui une décennie d’un pontificat profondément humain, singulièrement incarné, souvent contesté mais toujours engagé.
Élu en 2013 dans le sillage du renoncement historique de Benoît XVI, Jorge Mario Bergoglio était devenu pape dans des circonstances exceptionnelles. Premier latino-américain à accéder au trône de Saint-Pierre, premier jésuite, premier à choisir le nom de François en hommage au poverello d’Assise, son pontificat a été celui de l’inédit — mais aussi de la fidélité à l’Évangile des pauvres, des marginaux, des oubliés.
Le pape François fut un homme de contrastes assumés : inflexible sur certains dogmes de l’Église, mais audacieux dans son rapport au monde. Défenseur infatigable des migrants, des peuples autochtones, des exclus du développement, il osa, dès 2015, alerter le monde entier sur la responsabilité morale de l’humanité face à la dévastation écologique, à travers son encyclique Laudato si, texte fondateur d’une nouvelle conscience spirituelle du climat. Mais il fut aussi un homme de douleurs physiques : opéré à plusieurs reprises, affaibli par une pneumonie et des complications respiratoires, il avait, ces derniers mois, continué à exercer sa charge malgré les épreuves, se déplaçant en fauteuil roulant, sans jamais abdiquer.
Sa mort, bien qu’annoncée depuis des mois dans les murmures prudents du Vatican, laisse un vide immense. L’Église catholique perd une figure pastorale profondément attachée à l’essence du service, un pape qui préférait les périphéries aux palais, les gestes aux dogmes, les silences au tapage. L’homme de Buenos Aires, ancien professeur de littérature, fervent supporter de football, amoureux de Borges et de Proust, aura laissé à l’histoire une empreinte à la fois simple et singulière : celle d’un homme qui croyait que la bonté pouvait s’exercer depuis les plus hautes sphères de l’institution sans renier l’humanité profonde des humbles.
En Haïti, sa mémoire restera vivante. Depuis le tremblement de terre de 2010 jusqu’aux crises sociales, politiques et humanitaires récurrentes, le pape François a toujours porté le peuple haïtien dans ses prières et ses discours. À plusieurs reprises, il a exhorté la communauté internationale à ne pas abandonner cette « nation martyrisée », appelant à une solidarité active et durable. Dans ses mots comme dans ses gestes, il a reconnu la grandeur du peuple haïtien, sa foi inébranlable, sa dignité dans l’épreuve. Les évêques d’Haïti, les prêtres, les religieuses et les fidèles n’ont cessé, en retour, de manifester leur attachement à ce pasteur universel qui parlait avec le cœur.
Aujourd’hui, dans les chapelles de Port-au-Prince, dans les paroisses rurales du Plateau Central, dans les églises de Jacmel, du Cap-Haïtien ou de Jérémie, les cloches sonnent avec une solennité rare. L’Église catholique en Haïti perd une figure paternelle, un guide spirituel qui, sans jamais venir fouler notre terre, aura su parler à notre âme.
Le pape François disait souvent qu’il ne craignait pas la mort, car il croyait que la miséricorde de Dieu est plus grande que toutes nos limites humaines. En ce jour de deuil, cette foi simple mais puissante devient notre héritage. L’évêque de Rome a rejoint la maison du Père, mais son appel à l’humilité, à la justice et à la paix continue de résonner, plus fort que jamais, dans l’histoire du monde… et dans le cœur du peuple haïtien.

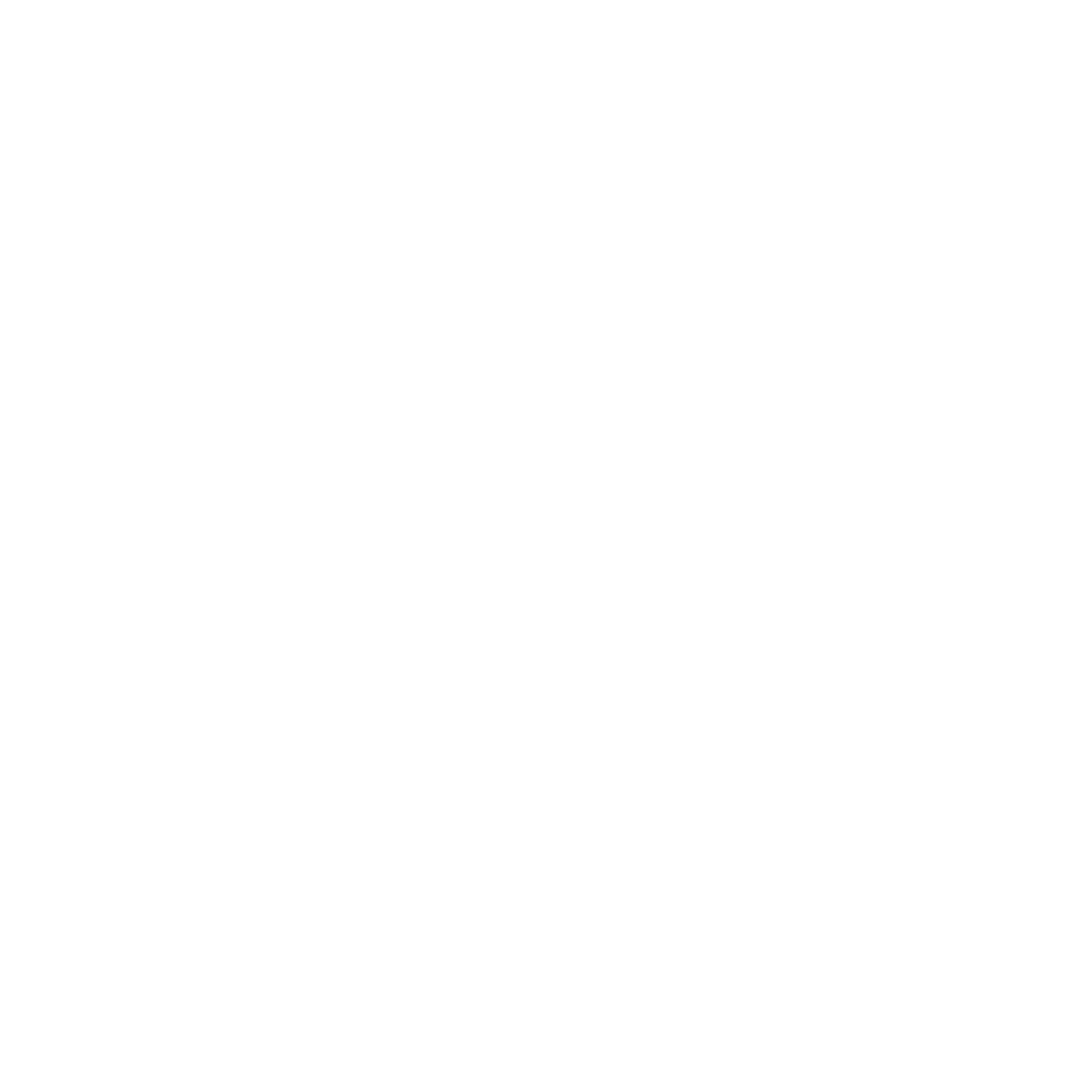





![[ID: OEidDdWFsxc] Youtube Automatic](https://www.radiotelecaraibes.com/wp-content/uploads/2025/03/id-oeidddwfsxc-youtube-automatic-236x133.jpg)

![[ID: HYlVE2-CTlo] Youtube Automatic](https://www.radiotelecaraibes.com/wp-content/uploads/2024/11/id-hylve2-ctlo-youtube-automatic-236x133.jpg)

